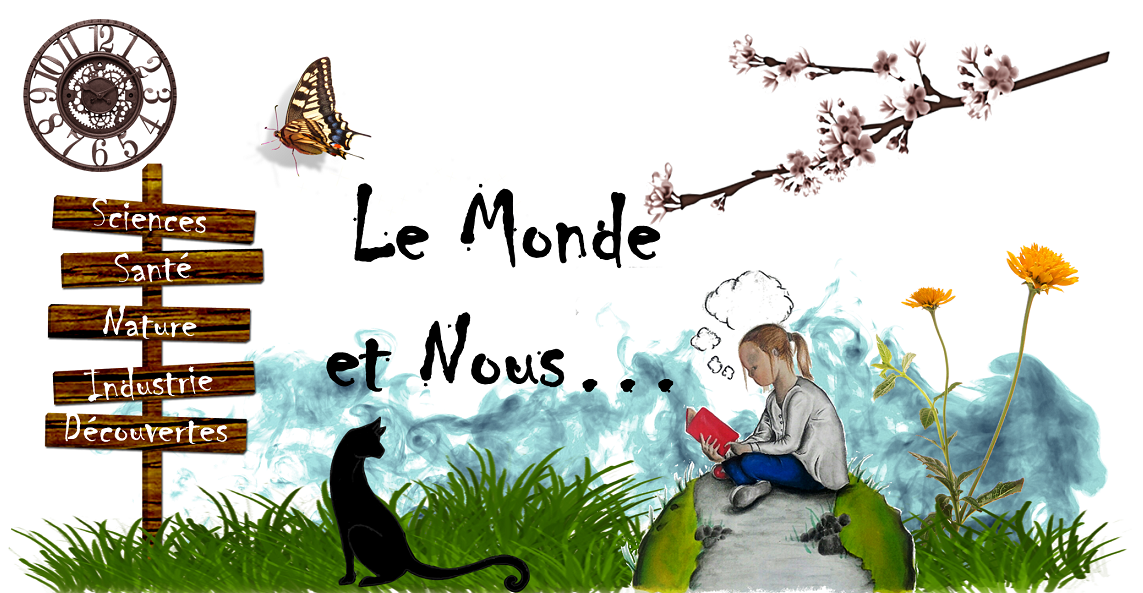Un très long moment s’est écoulé depuis mon dernier article… Pas de pause de mon côté, niveau vulgarisation des sciences (allez faire un tour du côté de Kidi’Science, le blog et l’asso) et puis j’ai aussi changé de format, puisque je m’adonne aussi assez souvent à l’écriture de carnets en version « manuscrite », des carnets de botanique, de voyage ou de culture, tout simplement…
Ce qui m’a fait reprendre le chemin de cet espace, le « Monde et Nous » est ma participation à un atelier de réalisation de bijou lors de mes vacances au Cap Ferret. Un rapport avec les sciences ? Oui, tout à fait ! J’ai appris à polir une graine d’un palmier tropical, et ce faisant, est apparu sous mes doigts et mes yeux, un matériau qui n’a rien à envier à l’ivoire que nous connaissons sous nos latitudes! Sauf qu’ici aucun animal n’a été spolié de ses défenses ! Jugez plutôt du résultat…
 Regardez ce brillant !
Regardez ce brillant !
 Le matériau en question est d’ailleurs appelé ivoire végétal ou « tagua » (son nom espagnol) et l’arbre qui porte les fruits s’appelle le palmier à ivoire. On le retrouve en Amérique latine, en particulier en Equateur !
Le matériau en question est d’ailleurs appelé ivoire végétal ou « tagua » (son nom espagnol) et l’arbre qui porte les fruits s’appelle le palmier à ivoire. On le retrouve en Amérique latine, en particulier en Equateur !
Alors un grand merci à Kokobelli qui nous a accueillis (moi et un petit groupe de vacanciers) dans son univers et a généreusement partagé sa passion pour ce magnifique matériau. L’atelier est fantastique (tout attire l’œil) et la boutique regorge de trésors sortis tout droit d’une imagination poétique et façonnés avec dextérité et grand soin.
Et si nous parlions Sciences maintenant ? Voyons d’un peu plus près de quoi il est question.
Le fruit du palmier à ivoire
Plusieurs espèces de palmiers produisent des fruits et des graines capables de fournir le précieux matériau. Concentrons-nous sur l’un d’entre eux.
Le palmier à ivoire, de son nom scientifique Phytelephas aequatorialis commence à produire des fruits à partir d’une dizaine d’années.
Les fruits sont bien sûr issus de fleurs et on peut en trouver de deux types selon qu’on a affaire à un pied mâle ou femelle (c’est une plante dioïque). On parle plutôt d’une inflorescence, nom par lequel on désigne un ensemble de fleurs rassemblées comme de petits bouquets.

Fleur mâle du palmier à ivoire du Phytelephas aequatorialis

Fleur femelle du palmier à ivoire du Phytelephas aequatorialis
Ces grandes inflorescences émettent pas mal de senteurs (telles que le méthylanisole) qui jouent un rôle clé dans l’attraction des pollinisateurs… Et pour les fruits, il s’agit plutôt d’infrutescence* (comme pour l’ananas) : il s’agit tout simplement de l’évolution de l’inflorescence suite à la pollinisation.
Bref, l’infrutescence se présente sous la forme d’une grosse sphère qui peut atteindre 35 cm de diamètre ! Ce n’est pas rien !

Infrutescence du palmier à ivoire
Les contours de l’infrutescence sont plutôt géométriques, anguleux… Mais comme tous les fruits, elle contiennent en leur sein les fameuses graines. Comparons par exemple avec l’anatomie d’une pêche. On y voit que la graine est contenue dans l’endocarpe… C’est cette partie qui protège la graine, cette dernière étant composée de l’embryon (germe) qui donnera la future plante et de l’albumen, une grosse réserve nutritive permettant d’alimenter la future jeune pousse.

A maturité, les graines sont devenues très dures et l’albumen, blanc, constitué d’hémicellulose s’est transformé en un matériau blanchâtre : notre ivoire végétal.


20 mm (échelle de la barre blanche)
Une fine peau brune recouvre l’ivoire, c’est le tégument. En tranchant la noix en coupe transversale, on révèle la pureté du blanc mais aussi une lacune centrale en lien avec la contraction de la matière due au séchage, cette phase pouvant durer plusieurs semaines.
Des études se sont penchées sur ses caractéristiques mécaniques : sa densité est d’environ 1,2 ± 0.2 g/cm3 (une valeur plus faible que celle de l’ivoire des défenses animales, plutot proche de 1,7 g/cm3).
Par une analyse précise de la structure, les chercheurs ont observé des tubes principaux, de forme cylindrique, de diamètres variables (entre 25 et 50 micromètres) disposés en cercles concentriques, chaque cercle mesure environ 100µm. Sur ces tubes, s’appuient d’autres tubules plus fins disposés de façon radiale. Les auteurs de cette étude pensent que cela explique pourquoi le matériau ne réagit pas de la même façon selon la direction dans laquelle on l’étudie ou on le sollicite.


Voici donc un matériau durable qui n’a rien à envier à l’ivoire naturel ou certains plastiques.
L’effet « Wahou » du polissage
Alors, après moulte passages de bandes rugueuses (avec un grain de plus en plus fin) sur la fameuse Tagua brute, force est de constater que le brillant est au rendez-vous ! Comme si une couche de vernis y avait été apposée !
Pourquoi, comment ?
En frottant la surface, même si elle paraît lisse à l’œil nu, on parvient à gommer l’ensemble des petites bosses et creux qui sont présents à l’échelle microscopique.
Avec les aspérités, la lumière incidente se disperse dans toutes les directions (on parle de diffusion), ce qui donne un aspect mat. En éliminant au maximum les bosses et creux, les rayons lumineux se réfléchissent avec très peu de diffusion au sein de la matière : tel un miroir, nous obtenons le fameux effet brillant !
Références
Yinghao Chu, Marc A. Meyers et al. « A Sustainable Substitute for Ivory: the Jarina Seed from the Amazon », DOi: 10.1038/srep14387, 2015